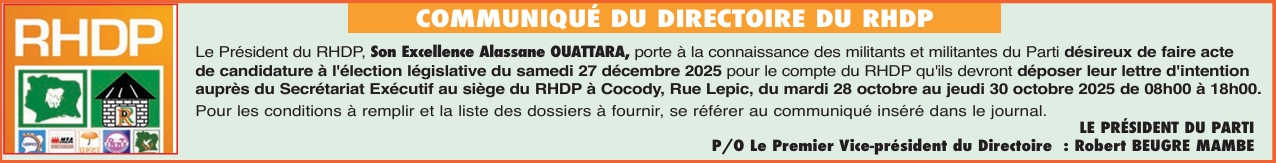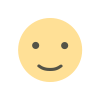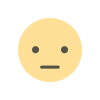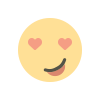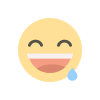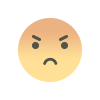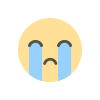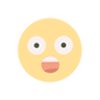Contribution : Tidjane Thiam et le secret d’État violé
Dans cette analyse, Kalil Coulibaly dénonce les manœuvres politiciennes de Tidjane Thiam tendant à faire croire que sa radiation de la liste électorale n’est pas justifiée.

L’échange entre le ministre Sansan Kambilé et Tidjane Thiam aurait dû demeurer dans la confidentialité des affaires d’État. Il ne portait, en apparence, que sur sa demande de certificat de nationalité, un acte banal de la vie administrative.
Mais le contenu relatif à l’obtention d’un simple document s’est mué en drame politique dès lors qu’il a été projeté sur la place publique. La question fondamentale devient alors : qui avait intérêt à ce que ce message circule ?
Certainement pas un ministre, qui n’y gagne qu’une perte de crédibilité. L’unique bénéficiaire de la fuite est Tidjane Thiam lui-même, incapable d’obtenir par la voie légale ce qui devrait être une formalité pour tout citoyen.
L’éthique, talon d’Achille de Tidjane Thiam
Le problème est d’abord éthique, et la coïncidence avec d’autres affaires similaires dans une vie antérieure est mordante. Tidjane Thiam, qui fut poussé à quitter la direction de Crédit Suisse pour manquement à l’éthique, se retrouve à nouveau empêtré dans une affaire où la transparence qu’il invoque ressemble à une manipulation.
Loin de respecter la discrétion due à un interlocuteur officiel, le ministre de la Justice, il instrumentalise leurs échanges afin de se poser en victime d’un système, alors qu’il est lui-même à l’origine de la sollicitation du certificat, et de l’orchestration de la fuite de l’information. Ce geste rappelle davantage une mise en scène qu’un acte de sincérité.
La manœuvre : transformer le juridique en politique
La stratégie est claire : transformer une difficulté juridique en affaire politique. Le dossier révèle pourtant une absence de fondement solide. La mère, ne disposant que d’un passeport diplomatique, ne peut transmettre une nationalité d’origine à son fils. Le père, naturalisé ivoirien, éteint définitivement la prétention de candidature à la présidence à son fils. Face à cette complexité, Tidjane Thiam préfère pointer du doigt le pouvoir. En exhibant ses conversations d’arrangement politique, il tente de convaincre l’opinion que son exclusion serait orchestrée par le pouvoir, un adversaire, plutôt que d’assumer la réalité juridique de son parcours.
Une confiance brisée, une crédibilité compromise
Sur le plan théorique, cette pratique s’inscrit dans ce que Pierre Bourdieu appelait la « lutte pour la légitimité symbolique » : faute de répondre aux critères juridiques, on recourt à l’opinion publique pour créer une pression politique.
Elle rappelle également la logique de l’« éthique de conviction » décrite par Max Weber, où l’acteur se sent autorisé à trahir la responsabilité institutionnelle au nom d’un idéal autoproclamé. En réalité, il s’agit de calcul : transformer un vide légal en bataille morale.
Un tel comportement interroge la crédibilité de Tidjane Thiam : si un homme aspire à la présidence mais ne peut respecter la confidentialité d’un ministre bienveillant qui lui tend la main, comment garantirait-il demain le secret des conseils de cabinet, des négociations diplomatiques ou des dossiers sensibles de la République ? La confiance, ciment du pouvoir, se dissout aussitôt qu’elle est trahie.
Les conséquences sont doubles. Pour Tidjane Thiam, il se présente comme un homme en quête de légitimité, mais révèle surtout son incapacité à assumer la réalité juridique de son dossier. Pour le pouvoir, il est accusé d’entraver artificiellement un citoyen, alors que la difficulté relève de la loi. Ainsi, derrière l’apparente victimisation se cache une vérité plus amère : celui qui transforme ses fragilités personnelles en scandale public ne prouve pas sa force, mais son indignité à gouverner.
Kalilou Coulibaly, Doctorant EDBA, Ingénieur