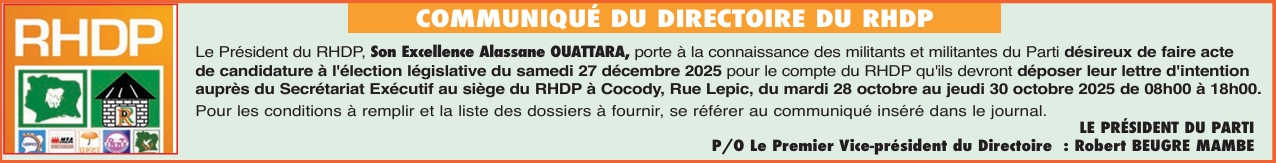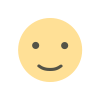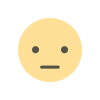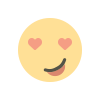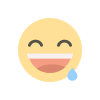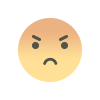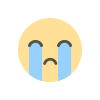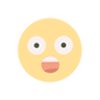Côte d’Ivoire : Le PPA-CI, une longue tradition de violence

La violence lui colle à la peau. Le Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), anciennement Front Populaire Ivoirien (FPI), a fait de la violence une marque de fabrique. Depuis le retour au multipartisme en 1990, impulsé par Laurent Gbagbo et ses camarades du FPI, la scène politique ivoirienne a été régulièrement secouée par des épisodes violents.
À l’époque, élèves et étudiants furent instrumentalisés pour descendre dans les rues, scandant des slogans hostiles au Président Félix Houphouët-Boigny. Le fameux « Houphouët voleur ! Houphouët voleur ! » résonnait dans les rues d’Abidjan, entraînant une longue fermeture des universités et écoles du pays, connue sous le nom d’« année blanche ».
Le 18 février 1992, le FPI, dirigé par Laurent Gbagbo, organise une marche pour réclamer davantage de démocratie. Le ton est donné : la rue devient un outil de pression politique.
Le 26 octobre 2000, après la proclamation de Laurent Gbagbo comme président de la République à l’issue d’une élection qu’il qualifie lui-même de « calamiteuse », les militants du Rassemblement des Républicains (RDR) manifestent pour exiger la reprise du scrutin avec la participation de leur leader. La répression est brutale. Un charnier de 57 corps est découvert à Yopougon, marquant un tournant macabre dans l’histoire politique du pays.
Quelques semaines plus tard, le 4 décembre 2000, le RDR organise une nouvelle marche pour réclamer la validation de la candidature d’Alassane Ouattara aux législatives. Les forces fidèles à Gbagbo répriment violemment les manifestants : une vingtaine de morts, des centaines d’arrestations, et selon un rapport de l’Association Ivoirienne des Droits des Femmes (AIDF), des cas de viols à l’École de police. Simone Gbagbo, alors Première dame, se contente de déclarer : « Elles n’avaient pas à être sur les lieux de manifestations. » Une phrase qui, pour beaucoup, résonne comme une justification implicite des violences subies.
En mars 2004, une coalition de partis d’opposition (RDR, PDCI, MFA, UDPCI) appelle à une marche pour exiger l’application des accords de Linas-Marcoussis. Des militants sont enlevés à leur domicile. Le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme sur les événements du 25 mars 2004 évoque une « tuerie aveugle de civils innocents » : « Sur la base de documents officiels, il y a eu 120 morts, 274 blessés et 20 disparus. Cette liste n’est pas exhaustive. »
Le 16 décembre 2010, en pleine crise post-électorale, les forces loyales à Laurent Gbagbo tirent à balles réelles sur des manifestants pro-Ouattara qui tentaient de prendre le contrôle de la radio-télévision nationale. Le bilan provisoire fait état d’au moins 30 morts.
Le 3 mars 2011, la violence atteint son paroxysme. À Abobo, sept femmes manifestant pacifiquement pour le départ de Laurent Gbagbo sont tuées par des éclats d’obus. Un drame qui bouleverse l’opinion nationale et internationale.
Tout au long de son parcours, le FPI – devenu aujourd’hui PPA-CI – a marqué l’histoire politique ivoirienne par des actes de violence qui ont profondément traumatisé la population.
Thiery Latt