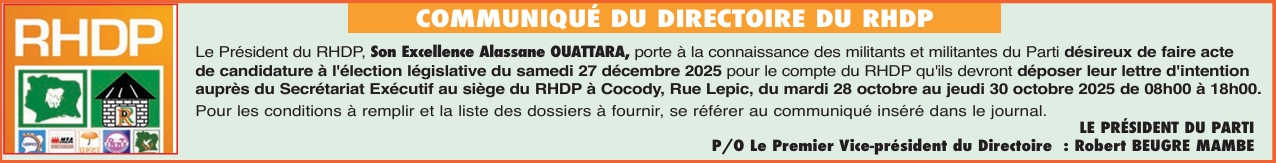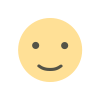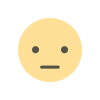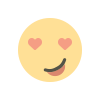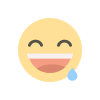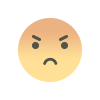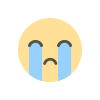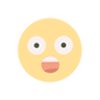Panier à crabes

« Il ne faut pas toujours tourner la page, il faut parfois la déchirer », disait le poète Achille Chavée. Une exhortation à rompre résolument avec les drames du passé et à éviter d’y replonger, par naïveté ou calcul politique. À moins de quatre mois d’un scrutin présidentiel capital, certains acteurs politiques ivoiriens semblent avoir tiré cette leçon. C’est le cas - du moins si l’on s’en tient à ses postures et prises de parole- de Charles Blé Goudé, président du COJEP et membre actif de la Coalition pour l’alternance pacifique.
L’ancien « jeune patriote », autrefois porte-voix de la radicalité sous Gbagbo, affiche depuis son retour de La Haye une mue remarquable. Il prône désormais la paix, l’humilité et l’urgence du dialogue national. Là où d’autres versent dans la surenchère verbale, il propose l’apaisement. Là où certains ressassent les plaies du passé, lui appelle à panser et à reconstruire. Cette voix inattendue dérange.
Et pour cause : une partie de l’opposition s’est engouffrée dans une logique d’affrontement systématique, usant de rhétoriques clivantes et de manœuvres de déstabilisation. Cette stratégie, fondée sur le soupçon, la désinformation et un storytelling victimaire, cherche à saboter un processus électoral pourtant encadré et transparent. L’objectif ? Délégitimer l’issue du scrutin avant même qu’il n’ait lieu.
Cette opposition bigarrée donne à voir un véritable panier à crabes : des figures politiques enfermées dans des calculs à court terme, tiraillées entre ambitions personnelles et rivalités familiales, incapables de bâtir un front cohérent. Et pendant ce temps, les rares voix modérées, conscientes des enjeux de stabilité et de cohésion sociale, peinent à se faire entendre dans le tumulte.
Blé Goudé, en appelant à une opposition républicaine et constructive, rompt avec le bruit ambiant. Il défend, sans reniement de son passé, une posture nouvelle : celle d’un acteur politique conscient que les peuples n’attendent plus la revanche, mais la vision. En cela, il incarne, plus que d’autres, une forme de maturité politique.
Mais ses prises de parole, parce qu’elles détonnent, s’attirent les foudres de ses anciens camarades de lutte. Ce rejet témoigne d’un malaise profond : celui d’un espace oppositionnel miné par les rancunes internes, dépourvu de ligne programmatique solide et incapable de fédérer au-delà de ses bastions traditionnels.
Les figures tutélaires de cette opposition peinent à convaincre. Gbagbo, revenu de La Haye mais prisonnier d’un logiciel politique dépassé, semble ignorer que le pays a changé. Tidjane Thiam, malgré son parcours international, donne l’impression d’un homme parachuté, étranger aux réalités du terrain. Ni l’un ni l’autre ne parvient à incarner une alternative crédible. Pire, tous deux, prisonniers des caciques de leurs camps, projettent une opposition figée, sans imagination, en décalage avec les attentes d’une population qui aspire à du concret.
Le contraste avec le RHDP, parti au pouvoir, est saisissant. Fort de son ancrage territorial, de son appareil militant et d’un bilan difficilement contestable, le parti présidentiel aborde cette échéance avec sérénité. Il n’a pas besoin de discours tapageurs : les faits parlent. Routes, ponts, écoles, centres de santé- les transformations sont palpables. Et surtout, le RHDP est structuré. Il n’est pas un conglomérat d’intérêts antagonistes, mais une formation hiérarchisée, disciplinée et préparée à gouverner.
Il n’est donc pas étonnant que les Ivoiriens -de plus en plus hermétiques aux manipulations - regardent avec méfiance et défiance cette opposition éclatée, qui préfère le bruit à la construction, et la critique stérile à la proposition. Là où on attendait des idées, on reçoit des attaques. Là où il faut bâtir une vision, on observe des règlements de comptes. De tels errements éloignent chaque jour un peu plus l’opposition du peuple.
Le 25 octobre prochain, les urnes auront le dernier mot. Mais déjà, dans les conversations de quartier, dans les marchés et les écoles, l’opinion se dessine. Elle penche du côté de la stabilité, de l’action, du réalisme. Elle refuse de faire un saut dans l’inconnu au nom d’un changement flou porté par des acteurs usés.
Entre la promesse incantatoire de la rupture et la preuve tangible de la continuité dans la paix, le choix -pour une large majorité- semble scellé.
Charles Sanga