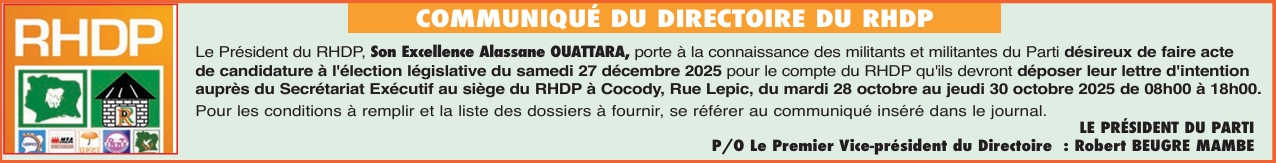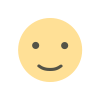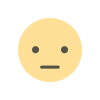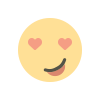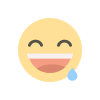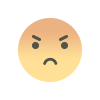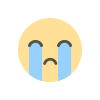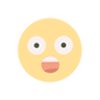CEDEAO : aller à l’essentiel

À l’origine, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) n’était qu’un idéal. Puis cet idéal se matérialisa en projet avant de devenir une réalité. Lorsque, le 28 mai 1975, les chefs d’État de la sous-région se réunirent à Lagos pour poser les fondations de cette organisation, ils étaient bien loin d’imaginer l’ampleur qu’elle prendrait cinq décennies plus tard : une communauté économique régionale des plus structurées du continent. Son parcours, jalonné d’ambitions et de défis, a vu naître de nombreuses initiatives ayant considérablement favorisé l’intégration des peuples et contribué au développement de l’Afrique de l’Ouest.
Cependant, ce chemin fut loin d’être de tout repos. Initialement composée de seize membres, la CEDEAO s’est longtemps maintenue à quinze, après le départ de la Mauritanie, avant de voir son effectif se réduire à douze, conséquence du retrait des États de l’Alliance des États du Sahel (AES) – le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette fragmentation, qui met en exergue les tensions politiques internes, a alimenté certaines critiques quant à son impartialité, accusée de fermeté envers les régimes militaires et d’indulgence à l’égard des gouvernements civils autoritaires.
Malgré ses limites, la CEDEAO demeure un outil incontournable pour l’Afrique de l’Ouest. Elle garantit la libre circulation des personnes et des biens, offrant à l’espace communautaire un marché de plus de 441 millions de citoyens. De surcroît, elle constitue un modèle accompli d’intégration régionale, permettant à tout ressortissant ouest-africain de s’établir librement dans un autre pays membre sans contrainte administrative.
L’ironie du sort veut que les nations ayant le plus bénéficié de cette intégration soient précisément celles qui ont décidé de s’en détacher : le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Leurs citoyens ont trouvé, au fil des décennies, un ancrage solide dans des pays voisins tels que la Côte d’Ivoire, le Ghana ou encore le Sénégal, au point que nombre d’entre eux ne conçoivent plus un retour au pays natal. Ce brassage est l’une des forces indéniables de la CEDEAO, en dépit des réticences de ses détracteurs.
Son rôle dans la pacification de la région témoigne également de sa pertinence, comme en attestent les interventions qui mirent fin à la guerre civile libérienne ou encore le soutien apporté au gouvernement légitime en Sierra Leone.
Si la CEDEAO n’existait pas, il aurait été impératif de la créer. Cet anniversaire offre ainsi l’opportunité de célébrer cette réussite en matière d’intégration régionale, en rappelant avec lucidité ses apports indéniables au développement ouest-africain. Malgré les tumultes, ses acquis surpassent largement ses lacunes. Dès lors, l’organisation doit poursuivre sa marche en avant sans s’attarder sur le retrait des États de l’AES, fruit de décisions unilatérales prises sans consultation populaire.
En cherchant à retenir à tout prix ces pays, la CEDEAO risquerait de s’entraver elle-même. Loin d’être un handicap majeur, leur départ représente 21,3 % des échanges commerciaux au sein de la communauté, tandis que les piliers économiques de la région – Nigeria, Côte d’Ivoire, Ghana et Sénégal – continuent de conférer à l’organisation une influence considérable.
Les douze nations restantes doivent ainsi consolider leur destinée commune en s’attelant aux défis cruciaux qui les attendent : le renforcement de la démocratie et de la gouvernance, l’approfondissement de l’intégration économique et politique, la préservation de la paix et de la sécurité. Parmi les chantiers prioritaires, on peut citer la lutte contre la menace terroriste qui s’intensifie aux frontières béninoises ou encore la concrétisation tant attendue de la monnaie unique.
Après un demi-siècle d’existence, la CEDEAO a encore fort à faire. Il lui revient désormais de focaliser son énergie sur l’essentiel : les initiatives servant les intérêts des peuples, plutôt que de s’évertuer à convaincre ceux qui ont fait le choix d’un autre chemin. Pour les décennies à venir, souhaitons aux dissidents de faire mieux que ce qu’ils ont reçu de cette communauté qui, elle, demeure un pilier fondamental du développement régional.
Charles SANGA