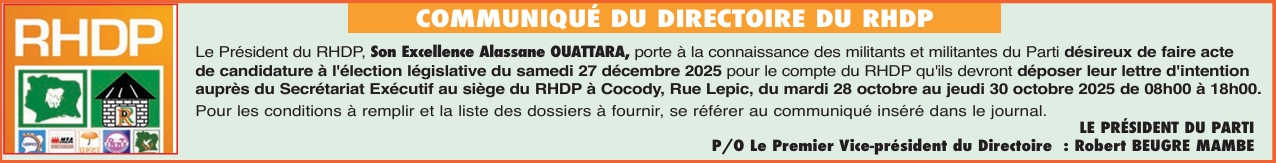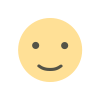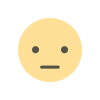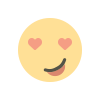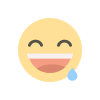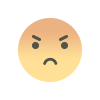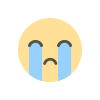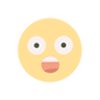Leçon d’Amérique

La séquence, pour le moins surréaliste, a fait le tour du monde. Dans un bureau feutré de la Maison Blanche, à Washington, le Président des États-Unis, Donald Trump, s'entretient, autour d'une table ronde, avec les chefs d'État du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Liberia, de la Mauritanie et du Sénégal. Le ton est relâché, l’attitude est condescendante : tel un maître s’adressant à ses élèves, le président américain interroge ses homologues africains sur leurs préoccupations, leur parcours et même… leur niveau linguistique. Félicitant le Président libérien Joseph Boakai, âgé de 81 ans, pour son « excellent anglais » – pourtant langue officielle du Liberia – il lui demande, avec une naïveté feinte ou une réelle méconnaissance, où il a appris la langue de Shakespeare. Il interrompt le président mauritanien, lui intimant d’arrêter les salamalecs et de « gagner du temps en allant à l’essentiel ». La scène, digne d’une comédie hollywoodienne, a suscité à la fois hilarité et consternation dans l’opinion africaine.
Au retour de cette visite officielle au pays de l’Oncle Sam, les cinq dirigeants africains ont été accueillis diversement dans leurs patries respectives. Certains reçus avec ferveur, d’autres plus discrètement, comme s’il fallait oublier les images devenues virales sur les réseaux sociaux. Mais que retenir, au fond, de cette rencontre médiatisée à l’excès, qui ne fut ni protocolaire ni productive ? Au-delà des cinq dirigeants concernés, c’est toute l’Afrique qui est interpellée. Les questions soulevées méritent une introspection collective.
Certes, l’Amérique de Donald Trump incarne une rupture dans la diplomatie traditionnelle. Le président, aux méthodes frustes et à la rhétorique provocatrice, a ébranlé les codes des relations internationales, reconfigurant brutalement les modalités de coopération, les priorités commerciales et les engagements bilatéraux. Toutefois, au-delà de cette brutalité diplomatique, le spectacle donné par cette rencontre est profondément affligeant. Il projette sur le monde l’image d’une Afrique marginalisée, caricaturée, souvent méprisée – une Afrique qui semble quémander davantage qu’elle ne propose, qui tend les bras sans maîtriser ses leviers stratégiques.
Disons-le sans détour : Donald Trump n’est ni un ami de l’Afrique, ni un fin connaisseur de ses enjeux. Durant son premier mandat (2017 - 2021), il ne s’est jamais rendu sur le continent. Dès les premiers instants de la réunion, il donne le ton : ces pays sont pour lui des terres « dynamiques avec des minerais fantastiques, des réserves pétrolières considérables».
Il n’a pas hésité à interdire l’entrée des ressortissants de sept pays africains (Congo, Érythrée, Guinée équatoriale, Libye, Somalie, Soudan, Tchad), à démanteler l’USAID – jadis pilier du développement dans plusieurs États –, et à menacer la pérennité de l’accord African Growth and Opportunity Act (AGOA), levier important d’accès des produits africains au marché américain
Ce nouvel épisode du « Trumperies » appelle les dirigeants africains à se réveiller. Car au-delà de la mise en scène politique, le miroir que tend cette rencontre est celui d’une Afrique fragmentée et vulnérable. Une Afrique qui, malgré sa richesse humaine et naturelle, n’occupe pas encore pleinement sa place dans l’architecture du monde. Désunie, elle sera instrumentalisée. Unie, elle deviendra une puissance incontournable, digne d’être écoutée et respectée.
Jamais les États-Unis ne recevraient des chefs d’État européens, asiatiques ou sud-américains en groupe avec autant de délassement. Le dialogue s’y fait de partenaire à partenaire, non dans un rapport vertical de maître à assujetti. Soit c’est face aux blocs régionaux comme l’UE, soit c’est de pays à pays.
L’Afrique, pour redorer son image et affirmer son rang, devra revitaliser ses institutions – trop souvent conçues sans volonté de les incarner – et renforcer son union continentale. En 2025, avec 1,55 milliard d’habitants (18% de la population mondiale) et plus de 60% des terres arables de la planète, elle représente une puissance latente. Son sous-sol regorge de métaux précieux (or, diamant, platine, cobalt, uranium, bauxite), de métaux de base (cuivre, fer) et de minéraux critiques pour la transition énergétique (lithium, graphite). Son potentiel énergétique – hydroélectrique, solaire, éolien, gazier – est colossal. Comme le disait Romain Gary, « l’Afrique ne s’éveillera à son destin que lorsqu’elle aura cessé d’être le jardin zoologique du monde ».
Ce scénario qui s’est passé aux Etats-Unis vaut pour toutes les puissances – asiatiques, européennes, américaines – qui accourent vers l’Afrique pour y négocier des « deals ». Certains sont indécents : investissements miniers en échange de rapatriement de migrants illégaux, comme le proposaient les Américains. D’autres, plus subtils, masquent les rapports inégaux derrière de fausses synergies : la Chine troque ressources naturelles contre infrastructures ; la Russie sécurité contre exploitation minière. Le principe est le même : défendre leurs intérêts, rarement ceux de l’Afrique.
Le véritable défi des leaders africains n’est pas de multiplier les clichés photographiques dans les palais occidentaux, mais de bâtir une souveraineté économique et institutionnelle pérenne. Cela exige une maîtrise rigoureuse des enjeux géopolitiques, une gouvernance exemplaire et un refus de l’assistanat structurel.
Tant que l’Afrique n’aura pas embrassé cette révolution politique, elle restera une terre riche en profondeur, mais pauvre en surface. Et – ce qui fait mal – un jouet pour les puissants.
Charles SANGA