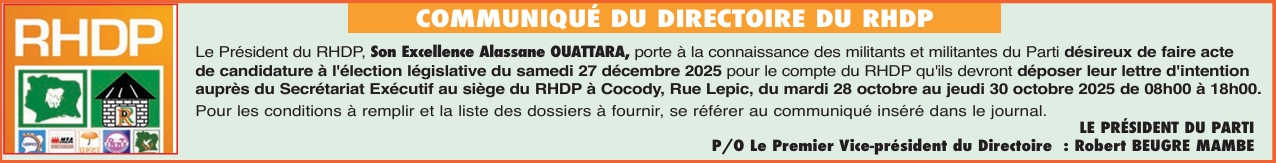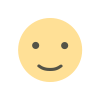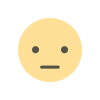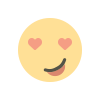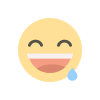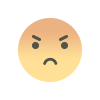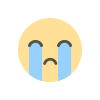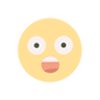Interview-Stéphane Rosenwald (Expert en intelligence économique) : "Pourquoi l'Etat et les entreprises doivent investir dans l'intelligence économique "
Dans un monde de plus en plus concurrentiel, l’information est une arme. L’intelligence économique, qui consiste à collecter, traiter, protéger et utiliser l’information stratégique, est aujourd’hui un levier essentiel de souveraineté et de compétitivité. Mais cette notion reste floue pour beaucoup, notamment en Afrique. Stéphane Rosenwald, dirigeant de GRC solutions et éventuellement professeur, administrateur de l’AFGE (Association Francophone de Gouvernement d’Entreprise), nous éclaire sur l’enjeu que cela représente pour les États, les entreprises, mais aussi les citoyens.

Le Patriote : Dans l’opinion publique, « intelligence » rime souvent avec espionnage. Est-ce vraiment ça, l’intelligence économique ?
Stéphane Rosenwald : L’intelligence économique, fondamentalement, c’est la maîtrise de l’information. C’est-à-dire la capacité à dominer cette matière première essentielle qu’est l’information. Et cette information, on va la maîtriser de trois manières principales. La première, c’est s’informer. Cela signifie aller chercher les informations qui vont nous permettre de comprendre les situations, de les éclairer, et ainsi, de disposer des bonnes informations, au bon moment, sous la bonne forme, pour prendre les meilleures décisions. L’objectif, ici, est d’avoir une vision claire et juste des choses pour pouvoir agir de manière efficace et adaptée à ce que l’on souhaite construire pour l’avenir. La deuxième dimension, c’est se protéger. Aujourd’hui, les données, les connaissances sont devenues fondamentales. Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement, exposé à de nombreux risques et à une forte concurrence. L’information est donc précieuse, mais aussi vulnérable. Il faut donc la protéger, car elle est constamment menacée.
Prenons l’exemple des cyberattaques : si l’on paralyse votre système d’information, vous ne pouvez plus fonctionner normalement. Si un virus bloque votre ordinateur, votre travail est compromis. De plus en plus, et même en Côte d’Ivoire, on voit apparaître des cas de piratage où des hackers prennent le contrôle de systèmes informatiques – comme ceux d’un hôpital – et exigent une rançon pour restituer les données ou rétablir les services. Dans ce cas, c’est la sécurité même des personnes qui est menacée. L’information peut être perdue, effacée, volée ou oubliée. Il faut donc mettre en place des stratégies de protection robustes.
La troisième dimension, c’est influencer. Toute entité – une entreprise, un État, une ONG, une famille – produit aussi de l’information. Et cette information alimente ce que l’on appelle le cycle de l’influence. Ce cycle fonctionne ainsi : je vous transmets une information, cette information va modifier votre perception, influencer votre compréhension du monde, et in fine, vos actions. L’objectif est que l’émetteur du message puisse tirer profit du comportement ou des décisions que vous prendrez à la suite de cette influence. Cela peut aller de l’achat d’un simple produit à un choix électoral ou à un changement de comportement collectif. L’influence, aujourd’hui, est donc un levier majeur. Et comme pour s’informer ou se protéger, elle doit être pensée de manière structurée. Cela implique de se poser les bonnes questions : Quel message souhaite-t-on transmettre ? À qui ? Pour obtenir quel résultat ? Et par quel canal ? Est-ce via un article de presse ? Une campagne de communication ? Une intervention ciblée ? Tous les moyens sont envisageables, à condition d’être choisis avec discernement. C’est ce qu’on appelle un plan de communication d’influence, de la même manière qu’il existe des plans de sécurité ou de collecte d’informations.
LP : Pour être plus concret : est-ce que cela veut dire qu’il y a quand même une part d’espionnage dans l’intelligence économique ?
SR: L’espionnage, c’est effectivement une forme d’intelligence économique, mais pratiquée par des acteurs – généralement étatiques – qui ne sont pas tenus de respecter les lois. Les services secrets, par exemple, peuvent agir en dehors du cadre légal classique. Mais dans le monde civil – c’est-à-dire les entreprises, les institutions, les citoyens – on doit respecter la légalité. Sortir du cadre légal vous expose à des poursuites, à des amendes, voire à des peines de prison. Et cela peut aussi nuire gravement à votre réputation, ce qui, dans un monde hyperconnecté, peut être encore plus destructeur.
L’intelligence économique civile repose donc sur deux piliers : la légalité et l’éthique. La légalité est claire : certaines choses sont interdites, point. Vous n’avez pas le droit de pénétrer par effraction dans une entreprise, de fouiller ses poubelles, ou de voler des données. L’éthique, elle, est plus subtile. Elle varie selon les contextes culturels. Ce qui est considéré comme astucieux dans le monde anglo-saxon peut être jugé inacceptable dans le monde francophone. Par exemple, envoyer un étudiant poser des questions à un concurrent en se présentant comme un stagiaire : c’est admis dans certains pays, mais considéré comme une manœuvre douteuse dans d’autres. Au final, même si une action n’est pas illégale, elle peut être jugée non éthique, et cela peut entacher votre image. Or, la réputation, aujourd’hui, est un capital précieux.
Donc non, l’intelligence économique dans le secteur civil n’est pas de l’espionnage. C’est une démarche légale, éthique, structurée, pratiquée de façon professionnelle et systématique. Elle vise à mieux connaître son environnement, à se protéger et à influencer intelligemment pour agir efficacement dans l’intérêt de son organisation.
LP : Est-ce que cette discipline est réservée aux grandes puissances, ou peut-elle aussi profiter à des pays comme la Côte d’Ivoire ?
SR: Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, tous les secteurs peuvent bénéficier de l’intelligence économique.
LP : Même un planteur de cacao peut en tirer parti ?
S.R: Absolument. Si vous êtes planteur de cacao, vous ne pouvez pas travailler "le nez dans le guidon" sans avoir une idée de ce qui se passe dans le monde autour de votre activité. C’est indispensable. Vous avez besoin de connaître le prix du cacao aujourd’hui, son évolution possible dans un avenir proche, l’identité des meilleurs intermédiaires, ceux qui sont sérieux et ceux qui le sont moins. Vous devez être informé des nouveaux traitements disponibles pour vos plantations, surtout s’ils sont plus naturels, moins coûteux, améliorent la qualité ou le rendement, ou réduisent les risques. Il faut aussi savoir s’il existe de nouvelles variétés de plants plus résistantes aux maladies, qui produisent davantage, etc. Même un petit ou moyen planteur a besoin d’informations fiables et actualisées pour bien travailler.
LP : Et dans les entreprises ? Qui est concerné par cette logique d’intelligence économique ? Seulement les cadres dirigeants ?
SR : Non, cela concerne tous les niveaux. Le directeur marketing a besoin d’informations pour anticiper les évolutions du marché, recommander des innovations, suivre les tendances technologiques, les attentes des consommateurs, ou encore ce qui se fait ailleurs. C’est le cœur de son métier. Mais le directeur commercial en a besoin aussi. Il doit savoir s’il ne passe pas à côté de clients potentiels, si ceux avec qui il travaille sont fiables, ou s’ils risquent des défaillances qui pourraient avoir des conséquences sur son entreprise. Il doit aussi savoir s’il y a de nouveaux distributeurs, de nouveaux magasins, des projets d’installation : toutes ces données influent sur sa stratégie. Et cela vaut aussi pour le directeur financier : il lui faut des informations sur les taux de change, les opportunités de placement, les conditions d’emprunt, ou encore la solvabilité de ses partenaires. Le directeur des achats, lui, doit identifier les fournisseurs les plus compétitifs, savoir s’il obtient les mêmes conditions que ses concurrents, ou si certains fournisseurs proposent ailleurs des produits ou des services qu’ils ne lui proposent pas. Même pour les responsables des ressources humaines, l’intelligence économique est essentielle. Ils doivent connaître l’état du marché de l’emploi, les attentes salariales, les écoles les plus performantes pour recruter efficacement, ou encore rester à jour sur la législation sociale, qui évolue constamment. En résumé, l’intelligence économique est un levier fondamental pour tous les acteurs économiques, en Côte d’Ivoire comme ailleurs.
LP : Mais la collecte d’informations en Afrique reste difficile. Comment avancer malgré cela ?
SR : C’est vrai : plus vous avez d’informations disponibles, plus c’est facile. Et en Afrique, en général, ce n’est pas évident. La Côte d’Ivoire n’est pas le pire élève, mais ce n’est pas encore idéal non plus. Il y a un vrai déficit d’information disponible. On progresse, bien sûr, mais il reste beaucoup à faire, notamment en matière d’open data. L’open data, c’est l’idée que les données publiques doivent être accessibles à tous.
LP : Vous évoquez les données publiques. Qui doit faire l’effort principal pour les rendre accessibles ?
SR : L’État, en premier lieu. Mais ici, même obtenir les adresses ou les numéros de téléphone actualisés des ministères peut s’avérer difficile. Parfois, vous cherchez le site web d’un ministère, et vous tombez sur un numéro obsolète. C’est problématique. Et ce n’est qu’un exemple.

"Si vous êtes toujours à la traîne, sans informations actualisées pour alimenter vos décisions, votre sort est scellé"
Prenez l’Institut national de la statistique : certaines données ne sont tout simplement pas disponibles en ligne. Évidemment, tout ne peut pas l’être pour des raisons de confidentialité ou de compétitivité. Mais il y a un minimum d’informations qui devraient être facilement accessibles. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Il faut parfois envoyer un courrier pour expliquer ce que vous cherchez, et ça prend du temps. Ce n’est pas logique. On ne se rend pas service. Au contraire, on se freine. Moins d’efficacité, plus de lenteur, moins d’agilité. Résultat : on se fait dépasser. L’État a donc un rôle majeur à jouer pour rendre l’information publique disponible et accessible.
LP : Parlons sécurité. Beaucoup d’entreprises utilisent des outils développés à l’étranger. Est-ce une faille ?
SR : Oui, une faille importante. Il est essentiel de protéger l'information, et pour cela, plusieurs moyens existent : physiques, électroniques, juridiques et humains. Ces quatre dimensions sont importantes, mais à la limite, la plus cruciale, c’est la dimension humaine. Pourtant, on commence souvent par l’aspect technologique. Le technologique, c’est la capacité à protéger ses données, qui sont la base même de l’information. Si vous hébergez toutes vos données dans le cloud via des hébergeurs internationaux, vous ignorez souvent où elles sont stockées, comment elles sont traitées, et avec quel niveau de sécurité. C’est un vrai problème. Cela touche à une question de souveraineté — ou plutôt, de souveraineté numérique.
LP : Concrètement, que peut faire un pays africain pour renforcer sa souveraineté numérique ?
SR : Il faut construire des infrastructures locales. Il est fondamental que les pays africains, individuellement ou collectivement, investissent dans des data centers locaux pour stocker et gérer leurs données, et en avoir une maîtrise complète. C’est crucial. On parle beaucoup de protection des frontières physiques, avec des postes frontières, des gardes, des militaires… mais les frontières numériques sont les nouvelles frontières qu’il faut absolument protéger. Cela concerne aussi les réseaux sociaux. Il n’est pas normal de laisser ces plateformes fonctionner comme des robinets ouverts qui déversent tout type de contenu sur nos territoires, sans contrôle, y compris auprès des plus vulnérables, comme les enfants. Il faut construire une véritable souveraineté numérique qui englobe les infrastructures, comme les data centers, et les usages.
LP : Et quand une entreprise ou une administration utilise Gmail ou Yahoo, est-ce aussi un problème ?
SR : Bien sûr! Lorsqu’on utilise des adresses Gmail ou Yahoo, tous nos messages et pièces jointes sont hébergés à l’étranger, sur des serveurs dont on ne sait ni la localisation, ni les conditions de sécurité. Or, certains États, comme les États-Unis, s’autorisent l’accès à certaines données. Selon mes informations, un éditeur de logiciel américain ne peut pas commercialiser un programme crypté qui ne soit pas accessible à l’administration américaine. Ça pose problème, non ?
LP : Donc même une simple adresse mail peut compromettre des données sensibles ?
SR : Exactement. Donc, utiliser des adresses Gmail ou Yahoo pour les services publics ou les entreprises, ce n’est pas raisonnable. Cela touche à la souveraineté numérique. On ne peut pas permettre à nos informations de « se promener » n’importe où. Il faut éduquer les citoyens, mettre en place des règles claires et organiser l’usage du numérique de façon souveraine.
LP : Revenons à la compétitivité. En quoi l’intelligence économique permet-elle aux entreprises africaines de mieux rivaliser avec les multinationales ?
SR : L’écart se creuse à partir de l’accès à l’information. Les multinationales disposent de toutes les informations possibles : elles connaissent l’état des technologies, des innovations, les attentes des consommateurs, la localisation des marchés… Elles savent comment s’organiser pour toucher les bonnes cibles. En face, si vous avez des entreprises locales qui sont à « l’âge de pierre », sans information, et qui fonctionnent uniquement au feeling du dirigeant — du genre : « je pense que », « j’ai l’impression que », « mon sentiment est que » — on ne joue pas dans la même cour. C’est le premier enjeu : la collecte de l’information.
Ensuite vient l’utilisation de cette information. Si les multinationales récupèrent des données, les analysent, les partagent, travaillent dessus de manière collective et structurée, elles sont forcément plus compétitives.
LP : Ce n’est donc pas une question de moyens uniquement, mais aussi d’organisation ?
SR : Tout à fait. Si les entreprises locales sont encore organisées à l’ancienne, avec un patron omnipotent, une structure très hiérarchisée, peu d’initiatives à la base, une circulation verticale et cloisonnée de l’information, elles partent avec un handicap majeur. Dans ces conditions, si l’entreprise locale ne capte pas la bonne information, ne la traite pas correctement, ne l’analyse pas en mobilisant ses différentes compétences, et ne la diffuse pas de façon collective pour prendre des décisions, elle est condamnée.
C’est pourquoi l’intelligence économique est un enjeu majeur de compétitivité. Et ce n’est pas seulement vis-à-vis des multinationales. C’est aussi face à des entreprises africaines voisines — béninoises, togolaises, sénégalaises, nigérianes, burkinabè — qui, si elles maîtrisent mieux l’information, vous dépasseront. Si elles pratiquent une intelligence économique plus poussée, elles auront l’avantage dans un monde qui bouge en permanence. Si vous êtes toujours à la traîne, sans informations actualisées pour alimenter vos décisions, votre sort est scellé.
LP : Est-ce qu’un pays africain a déjà réussi à bâtir une stratégie efficace d’intelligence économique ? Un modèle à suivre ?
SR : Il n’y a pas encore de modèle parfaitement établi, mais quelques exemples intéressants. Le Maroc a mis en place une intelligence économique adaptée à son contexte, avec des réussites notables, mais aussi des aspects moins convaincants. En Afrique subsaharienne, l’Afrique du Sud a mené quelques actions dans ce domaine, mais rien de très poussé ni de spectaculaire. Le Nigeria, de son côté, n’a pas fait grand-chose.
Cela dit, les entreprises, elles, en font forcément, car aujourd’hui une entreprise ne peut être performante sans intelligence économique. Si vous prenez un groupe comme Dangote, qui réussit de manière brillante, il est évident qu’il pratique l’intelligence économique. De grandes entreprises comme Michelin en font également beaucoup. Donc oui, toutes les entreprises performantes en font.
En revanche, au niveau des politiques publiques, aucun pays africain ne se distingue véritablement pour le moment.
LP : Et la Côte d’Ivoire dans tout ça ? Où en est-elle ?
SR : Elle a pris une certaine avance. Elle a un parcours intéressant en la matière, qui s’inscrit dans une certaine tradition impulsée dès l’époque du Président Houphouët-Boigny, notamment à travers la démarche prospective. Or, on ne peut pas faire de prospective sans faire d’intelligence économique.
La prospective consiste à anticiper les évolutions futures pour orienter les décisions stratégiques du pays dans son intérêt. C’est donc une forme d’intelligence économique. Il y a aussi la démarche des Compagnons de l’Aventure 46, que vous connaissez sans doute. C’était déjà une forme d’intelligence économique : se préparer à l’indépendance en formant des élites locales capables de porter le développement du pays. On a envoyé ces jeunes étudier, notamment en France, pour qu’ils acquièrent les savoirs nécessaires. Ensuite, sont venues les Études Nationales Prospectives (ENP). La plus récente, Côte d’Ivoire 2040, sert de base à l’élaboration des PND. Cette dynamique a conduit à la création du BNPVS — Bureau national de la prospective et de la veille stratégique — au début des années 2010. Très peu de pays africains disposent aujourd’hui d’un organisme équivalent. Le Sénégal, par exemple, ne s’est doté d’un tel bureau que récemment.
La Côte d’Ivoire est donc en avance. Il faut maintenant préserver et consolider cette avance, car le terrain est favorable, mais il ne faut pas s’endormir. Il faut continuer à développer cette approche. L’État doit y jouer un rôle central, mais les entreprises aussi.
Rahoul Sainfort