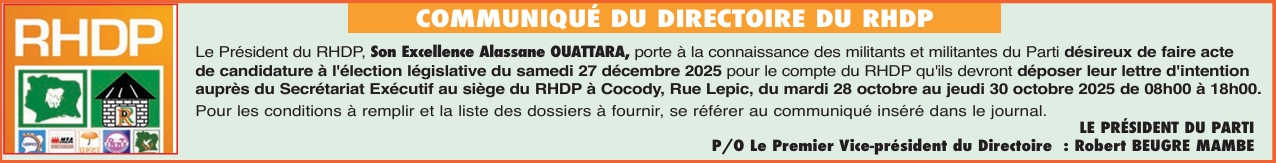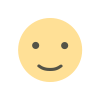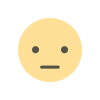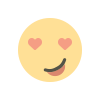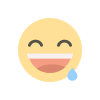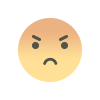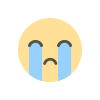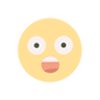Contribution : « On ne mange pas la paix, mais on mange mieux en paix » : La vérité silencieuse d’un bien vital
Communicateur de formation et stratège en communication institutionnelle, Norbert Kobenan a été conseiller technique chargé de la communication au cabinet du ministre Charles Koffi Diby. Il a activement contribué à l’obtention de la certification ISO 9001 du Trésor public. Dans cette contribution, il emboite le pas à Isidore Mvouba, président de l’Assemblée nationale de la République du Congo, qui récemment à Abidjan est revenu sur la nécessité de préserver la paix sur le continent et en Côte d’Ivoire.

Invité d’honneur d’un hommage républicain organisé en son honneur à Abidjan, le président de l’Assemblée nationale de la République du Congo, Isidore Mvouba, a pris la parole lors de la clôture solennelle de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale ivoirienne, le 30 juin 2025. Dans son adresse empreinte de sagesse politique et d’humanité, une phrase a résonné, comme sortie d’un vieux coffre de proverbes africains : « On ne mange pas la paix, mais on mange mieux en paix. »
Un aphorisme en apparence simple, mais d’une profondeur insondable. Il mérite que l’on s’y arrête, en ce moment même où l’Afrique peine encore à ériger la paix en colonne vertébrale de ses ambitions de développement.
La paix, ce capital invisible qu’on oublie de défendre
La paix est l’un des rares biens publics qui, paradoxalement, devient plus précieux à mesure qu’il est silencieux. Quand elle est là, on l’oublie. Quand elle disparaît, tout s’effondre.
Dans nos pays, aucun journal ne titre sur l’absence de conflits. Aucun flash spécial ne s’émerveille du calme dans les rues. Et pourtant, ce calme est la condition même de la vie. Ce sont dans les jours paisibles que se construisent les lendemains. Quand la paix est là, les enfants vont à l’école, les marchés s’ouvrent, les semences trouvent la terre, et les rêves, un avenir. Quand elle part, même la pluie devient menace.
La paix a un prix, mais la guerre coûte infiniment plus cher
Construire la paix exige patience, institutions fortes, dialogue constant, mémoire des blessures, volonté de réparer. Mais le coût de son absence est autrement plus lourd.
Selon l’Institute for Economics and Peace, les conflits armés ont englouti plus de 14 000 milliards de dollars en 2023, soit près de 13 % du PIB mondial. Que pourrait-on faire avec de telles ressources ? Des routes, des écoles, des hôpitaux, des politiques agricoles durables...
La paix, contrairement à une idée reçue, n’est pas gratuite. Elle demande des efforts constants. Mais ce sont des efforts qui rapportent. Car la guerre, elle, ne construit rien. Elle consume. Elle détruit. Elle laisse des ruines, visibles et invisibles.
L’illusion du ventre vide et la tentation du désordre
Il arrive que la pauvreté rende la paix suspecte. Certains disent : « À quoi sert la paix si le peuple a faim ? » Mais cette logique oublie une chose essentielle : sans paix, il n’y a ni culture de la terre, ni commerce, ni investissement, ni sécurité alimentaire.
On ne mange peut-être pas la paix au sens littéral. Mais elle crée l’environnement dans lequel on peut produire, échanger, épargner et transmettre. C’est elle qui donne sa stabilité à la monnaie, sa confiance au crédit, sa fiabilité au contrat. Sans paix, même l’aide humanitaire devient une aventure logistique.
Nos sagesses africaines en témoignent : la paix se cultive comme une terre fertile. Dans les traditions africaines, la paix n’est pas un état, mais un processus vivant, un bien à entretenir. Comme une plantation d’ignames, elle demande du soin, de la vigilance, du respect.
Les Baoulé de Côte d’Ivoire affirment : « Celui qui méprise la paix invite la famine dans sa maison. » Au Mali, on dit : « Le tam-tam de la guerre ne nourrit jamais, il fait fuir les troupeaux. » En Éthiopie, on enseigne que « c’est avec la paix qu’on remplit les greniers, pas avec les cris. »
Ces maximes ne sont pas que folkloriques. Elles rappellent que la paix est l’engrais silencieux de toutes nos espérances.
Il n’y a pas de paix durable sans justice sociale
Une paix imposée est une paix fragile. Une paix sans équité est une paix explosive. La vraie paix est le fruit d’une société qui reconnaît toutes ses composantes, qui répare ses injustices, et qui ouvre ses ressources à tous.
L’éducation civique, la tolérance religieuse, la liberté d’expression, l’équité devant la loi, la reconnaissance des mémoires blessées : voilà les briques d’une paix forte. Il faut y ajouter l’humilité du pouvoir et la vigilance citoyenne. Les sociétés durables ne sont pas celles sans tensions, mais celles qui savent les traverser sans se déchirer.
La paix est la table sur laquelle repose le festin de la vie
Non, on ne mange pas la paix. Elle n’est ni riz, ni pain, ni viande. Mais sans elle, aucune nourriture n’a de goût, aucune vie n’a de garantie. Elle est la table invisible sur laquelle repose le repas du monde. Elle est ce qui rend les jours supportables, les matins confiants, les projets possibles.
Alors que le monde bruisse de tensions et que certains rêvent de désordre au nom de revendications immédiates, souvenons-nous de cette vérité simple, mais profonde : la paix est lente, mais elle nourrit mieux. Et s’il faut un combat, qu’il soit pour la paix.
Par Norbert KOBENAN